Corinne ATLAN
Entre deux mondes
(Traduire la littérature japonaise en français)

Corinne Atlan, diplômée de l’INALCO, a enseigné le français au Japon et au Népal. Traductrice d’une soixantaine d’œuvres japonaises (roman, théâtre, poésie), notamment de nombreux titres de Murakami Haruki, mais aussi Murakami Ryû, Tsuji Hitonari, Inoue Yasushi ou encore Hayashi Fumiko,
elle a reçu le prix Konishi de la traduction en 2003
et le prix Zoom Japon en 2012.
Elle est également l’auteur de trois romans, Le Monastère de l’aube (Albin 2006),
Le Cavalier au miroir (L’Asiathèque 2014) et Un automne à Kyoto (Albin 2018).
Ce texte reprend la trame d’un bref essai, aujourd’hui épuisé,
publié en 2005 aux éditions Inventaire/Invention.
Il est ici présenté dans une version corrigée et complétée.
Corinne Atlan - Photo ©Atlan
Toute langue est intimement liée à une culture et à une histoire particulières. Or la traduction, si elle nous ouvre l’accès à un autre univers, le prive aussi de ce substrat d’origine. Le passage d’une langue à une autre gauchit des éléments fondamentaux qui concernent la mentalité profonde d’un peuple, son rapport au réel. Le rôle du traducteur - son impossible tâche - consiste à adapter une pensée à une grille de lecture du monde qui fondamentalement ne lui correspond pas. Aussi la lecture des traductions ne suffit-elle pas : il importe également d’interroger les limitations de nos propres acquis, de ne pas se fier exclusivement aux indications sémantiques de notre langue maternelle. « Porter le soupçon sur l’idéologie de notre parole », écrit Barthes dans L’Empire des signes.
Aucun fossé infranchissable ne nous sépare d’une culture a priori « étrangère », mais le rapprochement authentique ne s’obtient qu’au prix d’un décentrement conscient vers cet autre paysage intérieur. C’est seulement en s’intéressant véritablement à la parole de l’autre, en le rencontrant aussi dans son univers à lui, que peut s’ouvrir un nouvel espace commun, créatif et interactif, qui est le véritable enjeu de la traduction.

Le mot «roman» n'existe pas au Japon...
漢字 Photo ©Anne Uemura
Le mot « roman » au sens où nous l’entendons n'existe pas au Japon. Le terme correspondant, shôsetsu 小説, est composé de l’idéogramme 説, se rapportant à tout ce qui concerne le développement d’une pensée sous une forme écrite ou parlée - thèse, théorie, explication, prêche ou même rumeur -, précédé de 小, « petit », ici au sens de « mineur » ou « modeste ». Rien dans ce mot n’évoque la fiction ou l’imagination, ni même la narration. Il s’agit plutôt d’exposer une « opinion », plus précisément une opinion « modeste », et par extension « individuelle ». Le terme fut d’ailleurs utilisé d’abord pour désigner le shi-shôsetsu (私 小説) ou roman du « je », première forme que prit ce genre littéraire inspiré du modèle occidental, apparu après la restauration de Meiji (1868). L’introduction en masse des techniques et des savoirs occidentaux qui marque les débuts de l’ère Meiji entraîna l’adoption d’un certain nombre de vocables - souvent empruntés au chinois classique, langue dans laquelle ils existaient déjà, mais avec des acceptions différentes - destinés à exprimer ces nouveaux concepts. C’est le cas du mot 小説 shôsetsu (et également de 絶対, zettai, « absolu », dont il sera question plus loin).
Jusqu’alors, les récits narratifs étaient dénommés 物語 monogatari, terme qui traverse toute l’histoire de la littérature japonaise de Heian à la fin d’Edo, et que l’on traduit tantôt par « dit » (Genji monogatari - Dit du Genji, de Murasaki Shikibu), tantôt par « conte » (Ugetsu monogatari - Contes de pluie et de lune, de Ueda Akinari). L’appellation monogatari, littéralement «raconter une chose » [1], semble à bien des égards plus proche de l’acception française de « roman » que shôsetsu, et certaines œuvres romanesques s’apparentent encore aujourd’hui à ce genre, ou s’en réclament directement. La littérature moderne, issue à la fois de l’assimilation de la culture occidentale et d’une longue tradition ininterrompue propre à l’archipel, n’échappe donc pas à cette double appartenance que partagent tous les arts japonais depuis Meiji. Né sous l’influence du naturalisme russe et français (ce qui démontre en soi l’importance de l’acte de traduire dans l’évolution d’une littérature dite nationale), le roman japonais a également intégré divers éléments puisés à ses propres sources littéraires. C’est pourquoi sans doute il était inutile que le terme choisi pour désigner le « roman » fît référence à la fiction, ou à la narration : car au Japon, démêler la réalité de la fiction importe peu, de même que suivre un schéma narratif précis.
[1] Plus complexe que le « chose » français, mono désigne aussi bien des objets inanimés que la personne humaine, et des phénomènes visibles ou invisibles, tant réels qu’imaginaires.
Dans un article intitulé « Japon et Occident : fiction relative et fiction absolue » [2], le romancier et essayiste Shiba Ryôtarô examine le roman japonais sous un éclairage intéressant : les divergences de base entre le monothéisme et les conceptions religieuses prévalant au Japon (bouddhisme et shintô) fonderaient également les différences entre roman occidental et roman japonais. L'Occident croit en un dieu transcendant, créateur du monde, tandis que le bouddhisme fait le constat de l'existence d’un monde illusoire (ukiyo) dont il s'agit de se délivrer. Si les romanciers japonais de la fin du XIXe siècle se détournent assez rapidement du modèle européen stricto sensu pour inventer un genre propre basé sur l’observation de leurs propres vies, c’est précisément parce que la notion d’absolu leur reste étrangère.

[2] Cet article, inédit en japonais à ma connaissance, fut rédigé par Shiba Ryôtarô (1923–1996) à la demande du Nouvel Observateur, dans le cadre du Numéro hors série « 30 ans » paru en novembre 1994 à l’occasion des trente ans du magazine, et traduit en français par mes soins.
Shiba Ryôtarô 司馬 遼太郎.
Source : http://jptopic.org/トピック/司馬遼太郎/
« L'absolu est un concept occidental. Pour la pensée chrétienne, Dieu est l'être absolu, et en même temps le créateur du monde. Les Japonais, à l'inverse des chrétiens, n'ont jamais été des familiers de l'absolu, mais ont toujours pensé le monde en termes relatifs. Cette mentalité, originaire de l'Inde, n'est pas limitée au Japon : la Chine, la Corée, l'Asie toute entière la partage, à l'exception des pays de tradition musulmane. (…) Pour les bouddhistes, toutes les formes de vie sont interdépendantes, mais de nature essentiellement vides. Il faut vénérer exclusivement ce vide [3], cette vacuité (…), reconnaître qu'il n'y a nul paradis fictif auquel aspirer, que cette terre même est faite de vide, et que c'est à ce vide-là qu'il faut rendre grâce. Et nous, Japonais, avons encore aujourd'hui les pieds plantés sur cette terre pétrie d'interdépendance et de relativité. L'âme japonaise – à quelques exceptions près – est dénuée de cette "fiction absolue" que l'Occidental nomme Dieu. Certainement inspiré au départ par le roman occidental, le roman japonais en est fondamentalement différent : il a pour centre non pas une fiction absolue, mais un « moi » narratif qui est l'alter-ego de l'écrivain. »
« Les dieux du Shintô, poursuit Shiba un peu plus loin, sont pour nous les fragments d'une fiction relative. Lors des fêtes shintô, les divinités sont promenées rituellement entre des cordes délimitant leur territoire d'influence. De même, les auteurs de shi-shôsetsu ont exploré toutes les directions comprises entre les cordes du territoire mental japonais, avant d'offrir au public une œuvre tirée des lézardes qu'ils y ont rencontrées, non sans y ajouter bien entendu un peu de cette indispensable « sauce » qu'est la fiction. »
Le lien que Shiba établit entre roman japonais et conceptions bouddhiste et shintoïste du monde me paraît constituer une clé pour la compréhension de la littérature japonaise dans son ensemble.
[3] Eternel problème des différences de champ sémantique d’une langue à l’autre : « Vide » doit naturellement être pris ici au sens de « mu », la Vacuité bouddhique, et non au sens nihiliste. A tout prendre, cette notion se rapproche davantage du vide de la physique quantique que d’un concept philosophique occidental (哲学tetsugaku, « philosophie », fait d’ailleurs également partie de ces mots nouveaux inventés sous Meiji…)
La langue japonaise et la langue française témoignent d’une vision différente de la réalité, enracinée de manière plus ou moins consciente. Ainsi, au Japon, l’idée de « nature » n’a jamais été liée à un Dieu créateur, ni séparée de l’homme. Le terme correspondant, 自然 shizen, signifie littéralement « apparu (然) de soi-même (自) », et inclut l’être humain. Si la notion d’interdépendance – tout comme celle d’impermanence - chère au bouddhisme s’est intégrée sans difficultés à la mentalité japonaise, c’est qu’elle était déjà inhérente à la relation animiste avec la nature telle que la conçoit le shintô. Soumis à la loi universelle du changement, englobé dans le grand mouvement cyclique sans cesse recommencé qui se manifeste à travers les saisons, l’être humain est en adéquation étroite avec l’ensemble du vivant. « Aujourd’hui encore, écrit Tawada Yôko, qui vit et écrit en Allemagne, il m’est psychologiquement difficile d’employer des mots tels que « trompe », « gueule », « museau » ou « patte », qui me donnent l’impression de me couper du monde animal. A Hambourg, mon premier animal domestique fut un rat noir. Ce rat avait des mains et un visage. » [4] Rien dans le vocabulaire ne distingue l’homme de l’animal. De fait, selon la théorie de la réincarnation qui sous-tend la vision bouddhique de l’existence, chaque être humain a été ou sera un jour animal ou plante.
[4] Journal des jours tremblants, Verdier, 2012.

Animaux anthropomorphes du zodiaque chinois - Photo©Stuart Rankin Source : Japanese National Diet Library
Cette empathie avec la nature est particulièrement perceptible dans le haïku, où le poète peut s’identifier à la nuit voilée, à un arbre isolé dans la lande hivernale, à une carpe surgie de la vase, sans recourir à la subjectivité. Ainsi, quand Minayoshi Sôu écrit :
Pure fraîcheur automnale さわやかに sawayakani
moi la carpe おのが濁りを onoga nigori wo
je traverse les eaux boueuses 抜けし鯉 nukeshi koi
il exprime parfaitement l’identification du poète au poisson (avec pour corollaire la similitude entre la boue de l’étang et celle de l’existence) sans qu’il soit nécessaire de trancher grammaticalement pour l’un ou l’autre, ni d’ajouter un « je » comme en français. Le poète n’est pas seulement témoin des imperceptibles mouvements du monde : sa vie même s’y manifeste. L’immédiateté du haïku et les spécificités de sa langue permettent de partager cet « état d’esprit », au sens le plus fort du terme, et d’en propager longuement les échos.
L’élision du sujet n’est pas réservé à la poésie : il n’est pas obligatoire dans la phrase japonaise, et de fait, il en est absent la plupart du temps. Lorsqu’il est précisé, ce n’est pas tant en rapport avec une individualité qu’avec une hiérarchie sociale, familiale, où chacun occupe une place clairement établie, selon un système hérité du confucianisme. Le sujet (la première personne) est alors indiqué avec des subtilités que le français ignore. On utilisera ainsi watakushi (pour les femmes, ou les hommes en langage formel), watashi (exclusivement pour les femmes), boku (seulement pour les hommes, du petit garçon à l’adulte), ore (familier, réservé aux hommes, adolescents ou adultes), sans compter les divers ora, ono, onore, ware, waga, washi… La liste n’est pas exhaustive, et la seconde et la troisième personne disposent également d’un large éventail de variantes, dont les nuances ne concordent pas avec le français.
En regard de cela, notre « je » désigne une individualité bien définie mais paradoxalement exprimée par un terme unique qui vaut pour tous, en toutes circonstances. L’écrivain est alors une voix, un « je », parmi tant d'autres qui se réclament aussi de leur singularité. Dans une société où le collectif prime sur l’individu, le « je » de l’écrivain a un tout autre sens. La littérature de l'ère Meiji, avec le shi-shôsetsu, a donné sa véritable place au romancier, en lui confiant la mission de définir, à partir d’autres critères que ceux du groupe social, une « individualité » fondamentalement floue.
Seul l’écrivain est libre de s'exprimer en tant que « je » distinct. Aucune éthique ne lui dicte ce qu’il peut dire, ce qu’il doit taire. Il a pour devoir d’aller le plus loin possible dans l'exploration de l’esprit et de ses fantasmes. Cela reste, je crois, une caractéristique des écrivains japonais. (Je me rappelle encore le choc que m’avait causé, étudiante, la lecture de Confession d'un masque, le premier livre de Mishima Yukio que l’ai lu, et l’admiration ressentie dès lors pour l’absolue sincérité, jamais démentie, de cet auteur.)
Le rôle de l’auteur est celui d’un médium : à travers sa vie et l’exploration de son inconscient personnel, il rend compte de l’inconscient collectif de son peuple, de son époque. Dans l’image reflétée par le miroir de la littérature - comme dans les rêves, qui parfois nous effraient -, tout est permis. La parole de l’écrivain en tant que « je » est toujours écoutée, car elle représente celle des autres, qui n’ont pas droit à l’expression de soi : c’est en leur nom que parle la littérature. Et plus les individus sont muets ou oubliés, plus ceux qui leur prêtent voix se rapprochent de la puissance des oracles : c’est le cas notamment de Nakagami Kenji, dont l’œuvre est consacrée aux burakumin, ces parias parmi lesquels il a grandi. Malgré sa disparition prématurée en 1992, Nakagami reste l’un des auteurs japonais majeurs de l’après-guerre.
Depuis Meiji, ce « je » écrivant a bien sûr évolué, au fil des mutations de la société nippone. Le particularisme nippon, que soulignaient des œuvres comme celle de Kawabata, est aujourd’hui de moins en moins revendiqué par les auteurs japonais, qui s’inscrivent volontairement dans une proximité culturelle, par ailleurs bien réelle, avec l’Europe et surtout les Etats-Unis. Le plus représentatif à ce titre est certainement Murakami Haruki, considéré aujourd’hui comme le plus universel des romanciers japonais.
Il est pourtant, lui aussi, dans une certaine mesure, l’héritier du shi-shôsetsu de Meiji. Si ses personnages sont désormais bien définis, avec une histoire familiale, un passé, un nom et un prénom clairement affichés, parfois jusque dans le titre comme le Tazaki Tsukuru de son dernier opus, les narrateurs de ses romans, ont longtemps eu pour seul nom boku. Ce « je » évoquant un trentenaire urbain plutôt « cool », sonnait comme un nom propre. Répété presque à chaque phrase comme dans un énoncé en langue occidentale, ce sujet omniprésent valut à Murakami la réputation d’écrire dans un style « traduit », ou « destiné à la traduction », particularité qui bien entendu ne survit pas à la transposition du texte en anglais ou en français…
L’immense succès qu’il rencontra au tournant des années quatre-vingt auprès de la jeunesse de son pays est sans nul doute dû à ce « je » affirmé, dans lequel se reconnaissait toute une génération en quête d’individualisme, nourrie comme lui de culture américaine et d’idéal libertaire. La période « Boku », teintée de nostalgie et d’un humour mélancolique, reste d’ailleurs chère au cœur de ses lecteurs et traducteurs de la première heure.
Par ailleurs, si contemporaine et occidentalisée qu’elle soit, la réalité que décrit Murakami Haruki, pour peu qu’on l’examine à l’aune de sa japonité et non de son universalité, n’est pas identique à la nôtre, et reste étonnamment marquée par ses racines. Au Japon, en effet, contrairement à la perspective dualiste qui sépare l’homme de la création et la réalité de la fiction, on considère traditionnellement que rêves, fantasmes, pensées participent autant de la réalité que les événements ou objets concrets. On sait que la vie est un rêve. Bien sûr, cette idée n’est pas si étrangère à l’Occident (La Vie est un songe de Calderon de la Barca, les pièces de Shakespeare, ou encore nombre de contes de fée et récits anciens en attestent), toutefois elle n’est pas véritablement intégrée dans la culture. Ce monde que nous avons tendance à considérer principalement dans sa matérialité est au Japon un « monde flottant » (ukiyo) : illusion, rêverie, songe, sommeil, sont différents états d’un même continuum de conscience, et l’univers dans lequel nous évoluons naît de ces brumes flottantes, autant que de ce que l’œil et les autres organes des sens perçoivent.
Dans la terminologie bouddhique, ukiyo désigne ce champ de l’existence ordinaire, voué à la souffrance et à l’impermanence, issu des obscurcissements et des projections de l'esprit, par opposition au Nirvana, l’espace immuable de la conscience « éveillée ». (Par glissement de sens, le terme en est venu à désigner à l’époque d’Edo l’univers des marchands, des courtisanes et de la passion amoureuse que décrivent les estampes ukiyo-e, ou les ukiyo-zôshi, « Ecrits du monde flottant », de Ihara Saikaku, précurseur du roman naturaliste.)
Boku

Murakami Haruki
©Richard Dumas-Agence VU

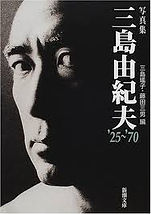
Mishima Yukio

Nakagami Kenji

Sakamoto Tokuro, Water Surface, acrylic on Kochi hemp paper, 1303x3240mm (2014)
Cette absence de frontière entre rêve et réalité, cette interaction entre intérieur et extérieur, reposant sur l’idée bouddhique que le monde est un reflet qui renvoie chacun à sa réalité intérieure, nous ramène au lien entre littérature et inconscient, et au rôle de l’écrivain chargé d’aller puiser au plus profond de lui-même des éléments communs à tous les hommes. Murakami Haruki, pour qui écrire consiste « à descendre au fond d’un deuxième sous-sol très sombre dont (il) ne connaî(t) pas l'issue » [5], se situe bien dans la continuité de ces auteurs « médiums ».
Ses romans débutent comme des romans policiers, mais l’assassin reste introuvable, car c’est dans son propre esprit que le lecteur est finalement convié à le chercher, ai-je pu lire un jour sur un site japonais, aujourd’hui disparu, qui lui était dédié. Murakami nous rappelle en effet que ce ne sont pas la logique ni la raison qui président véritablement à nos vies, et qu’il n’existe aucune différence essentielle entre rêve et réalité. On peut passer de l'un à l'autre sans heurt, dans une continuité de sensations : dans les halls d'hôtels les plus anodins s’ouvrent des corridors secrets, des portes dérobées menant vers l’intérieur de nos consciences.
En inscrivant cet irréalisme fantastique dans la réalité la plus plate, le romancier redonne au monde contemporain une dimension magique qui lui manque parfois. L’« angle mort » auquel il fait allusion dans Les Chroniques de l’Oiseau à Ressort est au cœur de toute son œuvre, et de nombre d'œuvres japonaises : le monde n'est pas ce qu'il semble être, il ne tient qu'à nous de soulever le voile, et la littérature nous convie à le faire. Un claquement de talons le long d'un couloir, la grille d'une usine qui grince dans le vent… Tout est source de poésie, l’instant le plus banal contient bien davantage que lui-même, et l’invisible a autant, sinon plus, d’importance que le visible. Comme dans le haïku, mais sous une forme longuement développée, l’instant « murakamien » nous livre simultanément un ensemble d’associations, souvenirs, connotations personnelles ou littéraires, sans qu’il soit nécessaire de « déplier » le temps en un récit construit. La dimension rêvée de l’existence accompagne chaque instant vécu de son cortège de fantômes.
[5] Conférence à Kyoto,
le 6 mai 2013.

武道館 Photo ©Anne Uemura
On rejoint ici une autre caractéristique de la littérature japonaise : un penchant à préférer la juxtaposition au déroulement d’un récit, la description du détail (l’instant, le fragment) à celle de l’ensemble (les péripéties d’une intrigue). Cette idée peut être ramenée à la forme même de l'écriture japonaise : la linéarité de l’alphabet donne une sorte de socle cartésien à la pensée, tandis que les traits juxtaposés des idéogrammes visent à représenter directement le monde sensible. De manière analogue, les Occidentaux tendraient plutôt à développer un récit à partir d’une succession d'éléments narratifs, tandis que les Japonais préfèreraient procéder par associations d'idées, collages, attention privilégiée au détail. (Kawabata et ses Récits de la paume de la main, en sont un magnifique exemple). Tout cela ne nous est pas complètement étranger, et les surréalistes aussi ont exploré ces directions. Il n’en est pas moins surprenant de constater à quel point, justement, certains procédés de la poésie classique japonaise sont proches des « cadavres exquis » chers à ces mêmes surréalistes.
L’écriture japonaise, cependant, demeure source d’une impossibilité fondamentale de traduction : les idéogrammes déroulent une sorte d’histoire parallèle sous forme de dessin, de tableau, tandis que l’alphabet nous oblige en quelque sorte à l'abstraction. Ici (ou devrais-je dire là-bas ? Mais pour moi le Japon est toujours, indéniablement, ici, où que je me trouve, tant il est vrai que nos atlas intérieurs, nos racines imaginaires, l’emportent sur les vérités de la géographie et du lieu où le hasard nous a fait naître), ici, donc, le monde est dessiné, et c’est bien ce qui m’a tout d’abord attirée vers la langue japonaise : le désir de décrypter le mystère de ces images. Elles semblaient en effet résulter d’une orientation du regard radicalement autre, très éloignée de la logique rationnelle véhiculée par les langues indo-européennes et l’ensemble des écritures phonétiques, y compris le sanskrit et l’écriture devanagari. Pour autant, il serait réducteur de considérer systèmes phonétiques et idéographiques de manière purement dichotomique. Une majorité de pays asiatiques a autrefois adopté, en même temps que le bouddhisme, l’écriture de l’Inde, terre d’origine de cette religion nouvelle et de ses textes sacrés, puis l’a adaptée sous diverses formes, preuve s’il en est que la pensée « extrême-orientale » n’est pas nécessairement liée à la graphie chinoise. Par ailleurs, outre les caractères chinois, le japonais utilise aussi un système phonétique, et notre alphabet a des pictogrammes pour origine…
Si la langue japonaise actualise les événements mieux que le français, les incarne davantage, épousant au plus près la réalité qu’elle décrit, c’est aussi grâce à l’immédiateté d’une grammaire où, par exemple, discours direct et indirect ne se distinguent que par l’introduction de l’enclitique to (と) maniable comme un unique guillemet. Le vocabulaire, également, fait une large place aux onomatopées, comme si les sonorités de la langue portaient le souvenir d’un temps lointain où elles étaient encore indissociées des bruissements et des fracas du monde.


Livre de Murakami Haruki - Source : Flickr Eiko
Que dire enfin de l’éventail de possibilités qu’offre l’originalité d’un système graphique à nul autre pareil, qui allie les idéogrammes chinois à deux différents syllabaires ? Les hiragana, cette souple écriture que les dames de cour de Heian mirent au service de chefs-d’œuvre fondateurs tels que le Dit du Genji ou les Notes de Chevet, gardent aujourd’hui encore une certaine connotation « féminine », et permettent une prononciation modulée au plus près de l’oralité. Les katakana, plus anguleux, réservés de nos jours à la transcription des mots étrangers, mais beaucoup plus largement utilisés entre Meiji et la seconde guerre mondiale, ont longtemps évoqué une certaine « martialité » teintée de nationalisme. Aujourd’hui, chez un romancier comme Murakami Haruki, l’usage récurrent des katakana confère d’emblée au texte, sinon une universalité, du moins une « étrangeté » certaine, tandis que chez d’autres auteurs les hiragana permettent de transcrire directement les accents régionaux, dans des dialogues dont la traduction ne peut qu’échouer à rendre la saveur (puisque toute tentative en ce sens tire fatalement le texte vers l’évocation d’une région française sans lien avec l’original). Quelles ressources offre l’alphabet pour transposer pareille richesse ?
Le choix de l’idéogramme peut également être signifiant et ajouter au mot une nuance supplémentaire, dès lors difficile à traduire. Ainsi, dans Le Bouddha Blanc de Tsuji Hitonari, le prénom de l’héroïne, Otowa est composé de deux caractères évoquant l’éternité avec une poésie dont j’aurais aimé rendre compte. Mais traduire un nom propre eût relevé d’un ethnocentrisme en vogue dans les traductions du début du 20ème siècle, qui n’a heureusement plus cours aujourd’hui. De plus, il me semblait qu’attirer artificiellement l’attention du lecteur par une traduction trop littérale ou une note pouvait déflorer le rôle de ce personnage, qui meurt très jeune et reste à jamais l’amour idéal du narrateur. Cette part irréductible, qui demeure inaccessible au lecteur français – et, peut également échapper à un lecteur japonais inattentif ou manquant d’érudition en matière d’idéogrammes, cas de plus en plus fréquent chez les jeunes générations - oblige le traducteur à accepter l’idée que l’on ne peut pas tout traduire. Dans la traduction comme dans toute forme de communication humaine, imparfaite par essence, demeure une part d’ombre, qu’il faut accepter - et écouter aussi, car elle ouvre encore sur d’autres échos, qui ne se déploient que dans le silence. La traduction, comme le langage, résiste à la volonté de tout dire.
Tout le travail du traducteur tient dans cette interrogation : comment transmettre l’« étrangeté » ? Comment en conserver la trace dans le texte d’arrivée, tout en rendant accessible une littérature issue d’une langue et d’une culture si différentes des nôtres ?
Si le traducteur tend à assimiler le texte d’origine à sa propre culture, il tombe dans le piège de l’ethnocentrisme. Mais si, à l’arrivée, l’œuvre reste par trop « étrangère », le lecteur français risque de la percevoir comme totalement extérieure à lui et donc parfaitement incompréhensible. Ainsi, en transmettant tels quels le monde et la langue de l’étranger, le traducteur manque également son but. Dans les traductions des années 1970 que je lisais, étudiante, la tendance était à rester le plus proche possible du texte original. Il fallait être extrêmement motivé pour lire de la littérature japonaise en français, et cela supposait l’acquisition préalable d’un certain nombre de références. Les lecteurs ignorant tout de la culture de ce pays – bien plus nombreux qu’aujourd’hui – devaient être pour le moins déconcertés, voire découragés par la rencontre en français avec des auteurs qui lui étaient présentés comme les plus accomplis de la littérature nippone : Abe Kôbô, Tanizaki, Mishima… Aujourd’hui, heureusement, Mishima n’est plus traduit de l’anglais, et Tanizaki a fait l’objet de nouvelles traductions.
Si donc le traducteur va trop vers la langue/culture ciblée par son travail, il court le danger d'élaguer, de censurer, aussi bien le fond que la forme du texte original. S’il penche trop du côté de la langue/culture source, il s’expose, en insistant plus que nécessaire sur des particularismes, à ne pas toucher le public visé et à livrer un texte qui ne sera plus un texte « littéraire » dans la langue d’arrivée. Je crois que les traducteurs ne sont au fond ni « sourciers » ni « ciblistes » selon la terminologie communément admise : ce sont plutôt des funambules. Sur le fil tendu entre deux langues, deux cultures, ils avancent pas à pas, à la recherche d’un équilibre délicat et jamais acquis entre ces deux extrêmes.
On évoque souvent la traduction en termes de fidélité au texte. Mais quel sens cela a-t-il dans le cas de deux langues qui pensent presque « à l’envers » l’une de l’autre ? La phrase japonaise, articulée différemment du français, demande une véritable réécriture. Si l’adaptation est bien entendu à proscrire, au nom du principe de base consistant à respecter la structure, la ponctuation et le rythme de l’énoncé original, il y a une part de création à assumer pour introduire certaines nuances grammaticales (dans l’expression du temps, notamment), ou au contraire éliminer les scories d’une syntaxe qui ne correspond pas à la nôtre. Traduire, c’est écrire dans sa propre langue.
La manière dont on traduit n’est pas seulement une question de choix personnel, mais aussi de politique éditoriale. La France étant assez ethnocentriste en la matière, il est demandé au traducteur de respecter avant tout les exigences du français littéraire en vigueur. Rien de plus naturel, certes, mais cela peut aussi limiter le champ d’action lorsqu’il s’agit de rendre compte de manière novatrice de l’originalité de certains écrivains. Le traducteur souffre alors de n’être pas considéré comme un « auteur » à part entière (bien que ce soit là son statut légal), et sa créativité est parfois bridée par une certaine exigence de textes « lisses », conformes aux attentes des éditeurs.
Le style est une question d’équivalences, toujours à réinventer, car cette notion répond à des critères différents en français et en japonais, en raison notamment de la complexité des systèmes d’écriture évoquée plus haut. La difficulté n’est donc pas toujours où on l’attendrait : il est parfois plus simple de trouver des équivalents à la belle langue classique de Hirano Keiichirô (jeune auteur réputé difficile), parce que le français s’y prête, qu’à la langue magnifique, heurtée, chaotique d’un Nakagami Kenji. Et la simplicité voulue, la musique particulière et limpide de Murakami Haruki - pourtant facile à lire en version originale - demandent un travail non négligeable pour être correctement rendues en français, langue précise qui répugne aux répétitions, alors que cet auteur (comme sa langue maternelle, de manière générale) les affectionne particulièrement, de même que les notions vagues et les « choses » (mono) indéfinissables…
La personnalité du traducteur intervient également : chacun a ses propres limites, son propre vocabulaire intérieur. Le traducteur idéal, transparent, qui s’effacerait complètement derrière le texte, est un mythe. Le traducteur met de lui-même dans le livre qu’il traduit, non en intervenant directement pour le modifier (la tentation existe, tant on aimerait traduire un roman « parfait »), mais parce qu’il y a un rapport « amoureux » avec le texte, comme pour un lecteur, et des passages dans lesquels, involontairement, on s’investit plus que d’autres. J’ai toujours été surprise de constater que les romans que j’avais le plus aimé traduire figuraient aussi parmi les plus appréciés des lecteurs (Le Bouddha blanc de Tsuji Hitonari, Les Bébés de la Consigne automatique de Murakami Ryû, La Fin des temps ou Kafka sur le rivage de Murakami Haruki).
Le travail du traducteur s’inscrit dans un système où lecteur et éditeur ont également leur place. Les choix des uns et des autres, principalement guidés par leurs émotions, leurs centres d’intérêts et leurs goûts littéraires (sans oublier bien entendu l’enjeu commercial pour les éditeurs), se conjuguent pour définir les contours d’une « littérature japonaise traduite en français », aussi distincte de la « littérature japonaise au Japon » qu’un texte original peut l’être d’un texte traduit.
Certains écrivains occupent ainsi en France une place qui n’est pas tout à fait la leur au Japon, tandis que d’autres, célébrés dans leur pays, n’atteignent jamais une véritable notoriété dans l’Hexagone. La reconnaissance d’un auteur est parfois un lent processus. Ce fut le cas pour Murakami Haruki, dont le succès au Japon date de la fin des années soixante-dix : largement traduit en français dès le début des années quatre-vingt dix, il est longtemps resté inconnu du grand public et boudé par une grande partie des amateurs de littérature japonaise. Mais, quels que soient les résultats de son travail en terme de ventes, la motivation principale d’un traducteur tient dans sa curiosité pour l’extraordinaire diversité de la production littéraire japonaise, jointe au plaisir de faire découvrir de nouveaux auteurs.
Selon un système de publication particulier au Japon, les œuvres sont souvent proposées d’abord au public sous forme de feuilleton, dans des revues littéraires, nombreuses et de grande qualité. Cela entraîne une structure particulière, puisque l’écrivain construit l’intrigue au fur et à mesure et se voit parfois contraint à rappeler certains éléments des « épisodes » précédents. Mais surtout, il en résulte ensuite des œuvres-fleuves, publiées en deux volumes de quatre ou cinq cent pages chacun. Un éditeur français peut, dans un contexte de crise, hésiter à les faire traduire, quelles que soient leurs qualités par ailleurs. Ainsi par exemple, un certain nombre de volumineux romans de Murakami Ryû ou Hirano Keiichirô, sortis au Japon ces dernières années et ne manquant pas d’intérêt, loin de là, ne verront peut-être jamais le jour en français.
Il peut aussi arriver que l’on aime profondément une œuvre, sans pour autant la proposer à la traduction, parce qu’elle se rapporte à un univers spécifiquement « japonais », dont la transposition poserait problème et risquerait de ne pas être saisie à sa juste mesure. Certaines œuvres ne seront sans doute jamais traduites (ou bien il s’agira de traductions « savantes », destinées à un public spécialisé), ce qui, là encore, déforme d’une certaine manière les véritables contours de cette littérature.
De manière générale, les connotations différentes d’une culture à l’autre sont une source de difficulté. Ainsi le papillon, que l’on retrouve, voletant en marge des rêves et de la mort, depuis la poésie classique et le haïku, jusque chez des auteurs contemporains aussi différents que Hirano Keiichirô ou Tsuji Hitonari, traçant la ligne ininterrompue d’une conception extrême-orientale du monde, définie par la célèbre interrogation de Tchouang-tseu. Quatre siècles avant notre ère, ce philosophe chinois se rêve en papillon, et se demande au réveil s’il n'est pas plutôt un papillon rêvant qu'il est Tchouang-tseu : le monde est-il réalité ou songe ? Jamais ce bel insecte printanier n’a atteint pareilles hauteurs chez nous - ce sont plutôt ses métamorphoses qui nous fascinent - et le lecteur français devra donc affiner sa perception au fil de ses rencontres avec des lépidoptères dans la littérature japonaise. Le cerisier, pour sa part, évoque en France la joie du printemps, les fruits juteux, le souvenir de vacances à la campagne, tandis qu’il symbolise au Japon la beauté éphémère du vivant, et autrefois celle du jeune guerrier, tombé au sommet de sa gloire. Les fleurs de cerisier sont d’autant plus belles qu’elles se détachent sur le gris des tombes, dans les cimetières où l’on pique-nique au moment de la floraison, tandis que brûlent les bâtonnets d’encens dédiés aux morts. Ainsi chaque mot évoque-t-il des images, des parfums, des souvenirs bien différents d’une culture à l’autre.
Mais n’est-ce pas le cas pour chacun de nous, au-delà des références culturelles communes ? Chaque lecture est singulière, et chaque lecteur opère sa propre « traduction » d'une œuvre, fût-elle rédigée dans sa langue maternelle.
Ce que doit avant tout percevoir et transmettre le traducteur, me semble-t-il, c’est l’intention de l’auteur. C’est cela qui compte, au-delà de toute fidélité syntaxique. Un auteur sait-il tout ce qu’il a mis dans son œuvre ? Les mots, écrits ou prononcés, ont une infinité d’échos qui nous échappent. Le traducteur doit constamment procéder à des choix, et ce sont toujours des partis pris, tant il lui est impossible de faire totalement abstraction de lui-même. La littérature, on le sait, est un art interactif : en l’absence de lecteur, elle reste lettre morte. Comment le traducteur ne serait-il pas créateur, quand chaque lecteur recrée l’œuvre à sa manière ? Comment le traducteur serait-il objectif, lorsqu’aucun lecteur ne peut l’être ?
Les choix conscients du traducteur sont posés avant tout par rapport au lecteur : quels éléments faut-il expliciter pour rendre compte avec précision d’un raisonnement dont la logique n’est pas celle du français, sur quelles références culturelles faut-il mettre l’accent pour éviter qu’elles passent inaperçues ? Le japonais, langue polysémique s’il en fût, abonde en doubles sens, allusions, ambiguïtés, comme si différentes strates de signification se superposaient, en un jeu presque sans fin de références littéraires se renvoyant les unes aux autres. Un lecteur japonais saisira d’emblée le lien implicite, directement issu de la poésie et de la littérature ancienne, entre la rosée et la fugacité des choses ou le sentiment amoureux, ou bien encore entre le son des cloches et l’impermanence, même s’il rencontre ces éléments dans un roman très contemporain. Qu’en sera-t-il du lecteur français peu versé dans les classiques extrême-orientaux ? Faut-il généraliser l’usage des notes, et opter, pour rendre compte d’une subtilité poétique, d’un procédé lourdement éloigné de l’effet originellement recherché ? Je ne le crois pas. Comme autrefois dans les versions grecques ou latines du lycée, en matière de traduction, le « contexte » reste un mot clé, et l’intention de l’auteur, la ligne qu’il faut continuer à fixer, à l’horizon des phrases.
Ainsi confronté à divers écueils, le traducteur, voyageur immobile en quête d’une unicité perdue, continue inlassablement à chercher des liens, entre sa langue et celle de l’autre, entre réalité et imaginaire, entre vie et écriture. Par le biais de passerelles qu’il voudrait toujours aussi légères et transparentes que possible, il s’efforce d'approcher le mystérieux fonds commun de la conscience humaine, ce lieu de convergence qui transcende le temps, les cultures, - et les mots.

Peter Wegner, HERE + THERE + HERE (RED CANCELLATION) (detail)
chalk powder on torpedo channels, 182" x 552" x 6", Tokyo (2006)


Le célèbre O'Torra, funambule japonais
Source : gallica.bnf.fr/Bibliothèque nationale de France, Fonds Jean Villiers (1897)
Hokusai, Pivoines et papillon (c. 1832) - Source : Musée Guimet, Paris


Corinne ATLAN
©2015 by Corinne Atlan/Tokyo Time Table
Photo©Jacques Khuong Nguyen
Japon, l'Empire de l'harmonie,
Ed. Nevicata, Bruxelles, 2016
Petit éloge des brumes,
Gallimard, 2019

Le Pont flottant des rêves,
La Contre-Allée, 2022
Le Cavalier au miroir,
Ed. Albin Michel,
2006
Le Cavalier au miroir,
Ed. L'Asiathèque,
2014
Un automne à Kyôto,
Ed. Albin Michel,
2018
Hayashi Fumiko,
Nuages flottants,
Picquier 2012
Haiku,
avec Zeno Bianu,
Gallimard, 2002
Okakura Kakuzô,
Le livre du thé,
Picquier rééd. 2017
Murakami Haruki,
Sommeil,
Belfond, 2010
Hirano Keiichirô,
Compléter les blancs,
Actes Sud, 2017
Isaka Kôtarô,
La mort avec précision, Picquier 2015
Shiba Ryôtarô,
Le dernier shôgun,
Picquier 2017

Okada Toshiki,
Ailleurs et maintenant, éd. Espace 34, 2018











