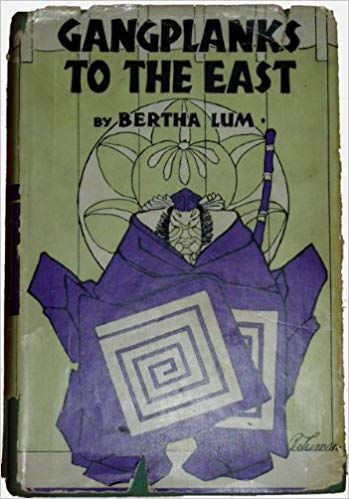Viviane LE BERRE
Pour l’amour de l’estampe :
Helen Hyde et Bertha Lum,
deux Américaines au Japon (1890-1940)

Viviane Le Berre

Bertha Lum
« Le japonisme était synonyme de libération.
La dictature de l’illusion naturaliste était sur le point d’être mise à bas par un art qui concevait avant tout la peinture comme la disposition de couleurs vives sur des surfaces planes..»

Helen Hyde
Lorsqu’en 1853, le Commodore Matthew Perry force avec ses frégates l’entrée du port de Kurihama, il met fin au « sakoku », la période d'isolement diplomatique, commercial et culturel du Japon, qui dura près de deux-cent-cinquante ans. Se répand alors, en Europe et aux Etats-Unis, une fascination pour les estampes japonaises nouvellement accessibles aux Occidentaux et pour l’art et la culture japonais en général.
Cette influence artistique du Japon sur l’Occident a été appelée « Japonisme » par Philippe Burty en 1872 et désigne l’étude et l’adoption de thèmes et techniques empruntés à l’art japonais par des artistes occidentaux. Elle a été théorisée en partie par Siegfried Wichmann dans son ouvrage de référence intitulé Japonisme en 1981, dans lequel on trouve repris les concepts fondamentaux qui, pour l’artiste et théoricien américain Arthur Wesley Dow avant lui, définissent la quintessence de l’art japonais. Il s’agit de la ligne, du notan (équilibre entre ombre et lumière), et de la couleur. Pour Siegfried Wichmann, la (re)découverte de ces aspects va libérer les artistes orientaux enfermés dans des carcans et des préceptes académiques poussiéreux : « Pour les impressionnistes et leur successeurs de la deuxième génération, le japonisme était synonyme de libération, grâce à la révélation de techniques qui leur permirent de s’affranchir des vieux concepts traditionnels de représentation tels qu’ils étaient enseignés dans les académies. (…) La dictature de l’illusion naturaliste était sur le point d’être mise à bas par un art qui concevait avant tout la peinture comme la disposition de couleurs vives sur des surfaces planes [1]. »
Certains rares artistes font même le déplacement jusqu’au Japon pour y étudier les estampes et en apprendre la technique de première main. Parmi eux, Helen Hyde et Bertha Lum, deux Américaines qui firent, à la fin du XIXème siècle, le choix de traverser le Pacifique pour s’établir de façon quasi permanente à Tokyo.
On peut s’interroger sur les raisons et les portées de ce choix pour les deux femmes artistes, d’un point de vue tant personnel qu’artistique. On peut également s’interroger sur le caractère moderne de leur entreprise, de leur œuvre et du regard qu’elles ont porté sur le Japon. De quel japonisme et de quelle modernité furent-elles les artistes ? Et quelles en furent les implications dans le contexte culturel et social de la fin du XIXème siècle ?

1. Helen Hyde
(1869-1919)

Source : Wikipédia
Helen Hyde, A Day In June (Un jour en juin), 1910
estampe, 37 x 16.6 cm
Art Institute of Chicago
Helen Hyde est née en 1868 dans l’Etat de New York mais sa famille déménage en Californie lorsqu’elle a deux ans. Originaire d’une famille aisée, elle est très tôt encouragée à se tourner vers les arts et bénéficie d’une solide éducation en la matière. Elle quitte les Etats-Unis en 1890 pour séjourner à Berlin puis à Paris, où elle étudie sous la tutelle de Félix Régamey et constate l’engouement parisien pour toutes choses japonaises. Après un retour en Californie, elle se rend au Japon en 1899 avec l’intention d’y prendre des cours de peinture auprès du réputé Tomonobu Kano.
Probablement sous l’influence d'Ernest Fenollosa, elle commence à s’intéresser à la technique de la gravure sur bois. Comme le veut la tradition de l’estampe dans le monde artistique japonais, Helen Hyde embauche, sous la gouverne de son éditeur Bunshichi Kobayashi, des graveurs et imprimeurs qui se chargent de graver le bois et d’imprimer les estampes qu’elle aura elle-même dessinées. Après quelques expériences malheureuses, elle décide de prendre en personne le contrôle de chacune de ces étapes de production et se met en devoir d’apprendre à graver elle-même le bois. Lorsqu’elle estime en avoir maîtrisé la technique, elle commence à commercialiser ses œuvres en Californie lors d’un bref passage aux Etats-Unis. Le succès en est immédiat et ne se démentira pas jusqu’à la fin de sa vie.
Durant ses années de résidence au Japon, Helen Hyde apprend le japonais et développe même son propre sceau en idéogrammes pour signer ses œuvres. Les aspects japonistes de l’œuvre de Helen Hyde sont évidents dans la plupart de ses gravures sur bois : le format en est vertical, elle emploie le procédé traditionnel de l’ukiyo-e avec gravure sur plusieurs blocs de bois, application de couleurs puis impression ; les thèmes, les tenues vestimentaires et les lieux sont tous empruntés à l’art japonais.
Elle travaille chez elle, avec son imprimeur Shohiro Murata, et s’habille souvent en kimono. Elle tient salon pour les expatriés tokyoïtes et sa résidence à Asakusa, dans le quartier des ambassades, devient bientôt un haut lieu de la vie sociale locale. Elle quittera le Japon en 1914 pour raisons de santé.

2. Bertha Lum
(1869-1954)

Bertha Lum dans son atelier
Source : Berthalum.org
Bertha Lum, Geisha Girls, 1908
estampe, 35.2 x 12.6 cm
Library of Congress
Bertha Lum, née Boynton Bull en 1869 dans l’Iowa, est originaire d’un milieu beaucoup plus modeste que celui de Hyde. Elle étudie pendant un an à l’Art Institute of Chicago où son professeur, Frank Holme, se met à la gravure sur bois après avoir lu l’ouvrage de A.W Dow, Composition, paru en 1899. Il semble que ce soit là le point de départ de l’intérêt de Bertha Lum pour la gravure.
Après avoir épousé Burt F. Lum à Minneapolis en 1903, elle obtient de lui qu’ils passent leur lune de miel au Japon où elle parvient (difficilement) à se procurer le matériel de gravure qu’elle rapporte aux Etats-Unis. C’est là qu’elle produira ses premières œuvres représentant geishas et femmes japonaises en tenues traditionnelles. Peu satisfaite cependant, elle décide de retourner au Japon pour y étudier auprès de maîtres japonais. Là encore, trouver un professeur s’avéra laborieux mais à force d’efforts elle y parvint, sous la houlette de Bonkotsu Igami. Elle effectuera plus tard un troisième séjour au Japon et y connaîtra même l’honneur de voir une de ses œuvres exposées au parc d'Ueno en 1912 (elle fut la seule artiste étrangère à voir son travail ainsi reconnu à Tokyo).
Bien qu’elles ne se soient vraisemblablement pas rencontrées, on trouve dans les biographies personnelles et artistiques de Helen Hyde et Bertha Lum de nombreux points communs. Leur intérêt pour les ukiyo-e tout d’abord, ainsi que leur pugnacité qui leur permit de bénéficier d’une éducation artistique japonaise à une époque où ce monde restait peu accessible aux étrangers et a fortiori aux femmes. Toutes deux menèrent par ailleurs à Tokyo une vie de quasi célibat (Bertha Lum vivait seule et divorça dans les années 1920, Hyde ne se maria jamais) et donc d’indépendance financière et conjugale.
Bertha Lum, originaire d’un milieu social modeste, connut pendant la crise de 1929 de véritables difficultés financières qui épargnèrent Helen Hyde, issue au contraire d’un milieu social privilégié. Lum se maria et eut deux filles, Hyde n’eut pas d’enfants. C’est paradoxalement Helen Hyde qui se tourna pourtant avec le plus de constance vers la représentation du thème de la maternité.

Helen Hyde, New Brooms, 1910,
estampe, 17x12.4 cm, Art Institute of Chicago
En effet, elle n’eut de cesse de peindre des mères à l’enfant et des bambins affublés de tenues traditionnelles japonaises. Les nombreuses représentations de marques de tendresse et d’affection semblent traduire chez elle une préoccupation pour le réalisme dans le portrait d’une intimité « universelle », celle des liens charnels unissant la mère à son enfant. On voit souvent dans ses estampes des femmes vaquer à leur quotidien ou des fillettes occupées à imiter les activités domestiques des adultes (voir New Brooms ou Cherry Blossom Rain).
Ces tableaux vivants et colorés connurent un franc succès chez les contemporain(e)s américain(e)s de Hyde, qui furent sensibles à l’aspect coloré des tenues mais guères dupes sur leur authenticité : « L’étranger voit [dans les estampes de Hyde] le Japon de ses rêves, celui qu’il a appris à aimer, celui qui l’a accueilli lors de son arrivée. Les femmes et enfants japonais (et en particulier ces derniers) ainsi perçus à travers les yeux d’un étranger, forment un tableau que les Japonais eux-mêmes ne sont guère en mesure de comprendre ni d’apprécier. Il est vrai que les charmantes petites créatures sorties de l’imagination de l’artiste, bien que revêtues des habits fleuris du Japon, lui sont par essence étrangères [2]. »
On voit qu’il s’agit d’une vision d’un Japon « tel qu’on le rêve », à travers un prisme occidental et qui « fit mouche » auprès du public visé par l’artiste.
3. Les thèmes de l'enfance
et de la maternité

Helen Hyde, Baby Talk, 1908
estampe, 28.8 x 46.4 cm, Washington, Library of Congress
Cet engouement de Hyde pour le thème de la maternité traité sur un mode japoniste pourrait avoir été en partie inspiré des oeuvres de la peintre américaine Mary Cassatt, dont on sait que Helen Hyde admira les oeuvres à Paris en 1893, et notamment sa série de dix eaux fortes japonistes. Les similitudes entre l’oeuvre japoniste de Cassatt (mais dont les estampes furent réalisées dans leur forme occidentale : eau forte ou gravure sur vernis mou) et les estampes de Hyde sont nombreuses. Le thème tout d’abord d’une maternité intime et domestique dépeignant des gestes maternels simples, les démonstrations d’affection et de tendresse d’une mère pour son enfant.
Le motif de l’enfant au bain représente en quelque sorte la quintessence du moment domestique, le soin quotidien de la mère à son enfant, intime et simple, a priori peu digne de représentation. On le retrouve déjà dans l’art japonais des années 1800, chez Utamaro et Hokusai notamment. Désormais, ce motif est repris en Occident. La référence à Utamaro est très claire chez Cassatt qui en reprend le thème, le style japonais et la position des corps, ce qui constitue déjà en soi une innovation artistique, mais elle va plus loin que la simple imitation artistique en s’appropriant le thème et en le modernisant. Le vêtement, la coiffure de la mère sont ancrés dans la culture occidentale alors que la forte présence de la ligne et du contour, les aplats de couleur ainsi que le cadrage de la gravure font penser quant à eux davantage à l’ukiyo-e japonaise.

Kitagawa Utamaro, Mère baignant son enfant, c.1801
estampe, 37.3 x 25.1 cm,
Metropolitan Museum of the Arts, NY

Kitagawa Utamaro, Mère baignant son enfant, c.1801
estampe, 37.3 x 25.1 cm,
Metropolitan Museum of the Arts, NY

Helen Hyde,The bath (Le bain), 1905
estampe, 41.4 x 25.9 cm,
C. Graeber collection
Helen Hyde en revanche montre une volonté claire d’imiter les ukiyo-e traditionnelles sans passer par une distanciation ou une modernisation dans le traitement du sujet qui semble demeurer proprement japonais : le vêtement, le décor appartiennent à un quotidien « exotique » pour un public occidental (bien qu’un œil plus habitué aux coutumes nippones puisse repérer quelques incongruités dans le choix de la ceinture obi notamment, qui n’est pas du modèle qu’on trouverait traditionnellement chez une femme mariée).
L’impression de domesticité qui prévaut dans cette estampe est renforcée par la présence d’un double encadrement, celui du paravent et de la fenêtre, et qui renvoie vers un espace domestique clos et défini, identifiable, fermé au monde extérieur (là où le dessin de Cassatt comme celui d’Utamaro semblent comme suspendus dans un espace non défini). Ceci contribue à donner au spectateur l’impression de surprendre un moment d’intimité partagée entre une mère et son enfant.

Helen Hyde,The Secret (Le Secret), 1909
estampe, 21.4 x 13.8 cm,
Art Institute of Chicago
Autre exemple, le thème de la mère à l’enfant. On sait que ce sujet, et celui de la Madone lorsqu’il s’agit d’une maternité divinisée, est omniprésent en Occident, mais qu’en est-il dans l’art japonais ?
On trouve chez Utamaro et Hokusai beaucoup de scènes d’allaitement et de jeu entre mères et enfants. Si la maternité divinisée quant à elle semble être moins présente au Japon qu’en Occident, elle existe néanmoins, notamment dans les représentations de Kannon Bodhisattva ou Kuan Yin en chinois ; c’est la déesse de la compassion, celle qui « entend les bruits du monde ». Kannon était représentée sous les traits d’un homme à l’origine mais en Chine on la trouve dépeinte indifféremment sous des traits masculins ou féminins. Sous sa forme de Jibo Kannon, ou loving mother, elle porte des valeurs proches de celles qu’un public occidental tendrait à attribuer à un portrait de Madone dans l’iconographie chrétienne - protection, amour filial, compassion. Représentée avec un enfant dans les bras ou semblant émaner d’elle, cette figure facilement accessible pour un public occidental a souvent été reprise dans un mélange des deux iconographies bouddhistes et chrétiennes, notamment par les chrétiens japonais lors des persécutions de la période Tokugawa.

Helen Hyde, A Japanese Madonna, 1900
estampe 36.7 x 9.5 cm
Library of Congress

Kano Hogai, Jibo Kannon, 1888
encre, couleurs et or sur soie,
monté sur panneau, 196 x 86.5 cm
Tokyo University of the Arts
Les thèmes de l’enfance et de la maternité sont aussi présents dans les premières œuvres de Lum, qui sont par ailleurs très similaires à celles de Hyde. Au fur et à mesure qu’elle réside au Japon cependant, elle trouve son propre style et se tourne vers des représentations d’une maternité divinisée, ce que fit moins Hyde. Après avoir peint également, dans les premières années de sa résidence, quelques geishas, elle finit par s’en détourner, jugeant que leur profession fait d’elle de « de charmants petits jouets/esclaves » et ses représentations de geishas se font de fait plus rares.
Hyde choisit d’intituler une de ses toutes premières œuvres Japanese Madonna et ce titre semble pointer vers une référence appartenant à l’iconographie chrétienne, ce que renforce le fait que les cheveux de la Madone soient recouverts d’un foulard.
Nancy Mowll Mathews, dans son ouvrages Mary Cassatt, une impressionniste américaine à Paris, signale qu’en histoire de l’art, le passage de scènes de la vie émotionnellement neutres à l’intensité d’une étreinte mère-enfant correspond à l'évolution de l’art et de la littérature en France, passant du réalisme du milieu du XIXème siècle au symbolisme des années 1880 et 1890. Les objets ordinaires servent alors, en peinture, de symboles religieux : une assiette suspendue au mur près de la tête d’une mère évoquerait ainsi, chez Cassatt, une auréole divine. Ceci n’est pas sans rappeler les ovales entourant les maternités de Helen Hyde dans Baby Talk, Daydreams et The Secret.

Helen Hyde, Daydreams (Rêveries), 1901
estampe, 27.6 x 27.8 cm,
Art Institute of Chicago
Deux estampes dans l'œuvre de Bertha Lum, Kuan Yin et Sea of Lilies, semblent s’inscrire également dans ce thème de la maternité divinisée. Sea of Lilies surtout, qui représente Kuan Yin entourée de deux enfants, paraît accompagnée de ces quelques lignes explicatives dans un recueil d’illustrations [3] : « Toutes les âmes doivent traverser la mer après la mort. Kwan Yin guide celles des petits enfants par-delà la mer de nymphéas. Les bulles représentent les âmes des enfants qui s’élèvent sur son passage. »


Bertha Lum, Kuan Yin, 1936
Illustration pour le livre
Gangplanks to the East
Bien qu’il s’agisse d’un homme et non d’une femme, on pourrait mentionner également une autre estampe de Bertha Lum, The Piper, qui mêle allusion à la légende nord européenne du joueur de flûte de Hamelin à une figure divine japonaise. Dans le conte populaire des frères Grimm, le joueur de flûte attire les enfants dans une cave et leurs parents ne les revoient jamais. Mais Lum choisit d’atténuer la portée macabre de cette version en représentant le joueur de flûte sous les traits de Jizo, le dieu japonais protecteur des enfants et des voyageurs. On lit dans le geste protecteur de Jizo ainsi que dans la complicité de l’enfant qui escalade son dos une attitude de mansuétude qui semble orienter la lecture de l’estampe vers une issue plus heureuse que sa version occidentale. Les deux estampes, Sea of Lilies et The Piper, évoquent le passage des enfants de vie à trépas guidés par une divinité bienveillante et protectrice.


Bertha Lum, Hollyhocks, 1908 estampe, 30,7 x 15 cm
Library of Congress
4. Estampe,
Art nouveau
et préraphaélites

Bertha Lum, Fox Women, 1907
Gravalos and Pulin, estampe, 37,2 x 21,8 cm
Library of Congress
Cette volonté de médiatiser le rapport entre l’homme et le divin, entre la vie et la mort dans le contexte de la spiritualité bouddhiste japonaise et shintoïste s'accentue chez Lum à partir de 1907 (date de son deuxième séjour au Japon, à partir duquel elle montre une maîtrise assurée du médium de l’estampe). Elle peint de plus en plus fréquemment des créatures issues de légendes mythiques et le fait en empruntant à l’art nouveau ses lignes fluides et ses arabesques. Il est intéressant de noter que la transcription écrite de ces légendes sont parfois le fait d’artistes occidentaux émigrés au Japon. C’est le cas d’Aoyagi, une légende que Lafcadio Hearn, poète irlandais et Japonais d’adoption, grand ami de Bertha Lum, fut le premier à traduire en anglais et à diffuser en Occident. Cette légende conte l’histoire d’une femme qui est en réalité l’esprit d’un saule pleureur et meurt lorsque son arbre est abattu, révélant de ce fait à son mari sa véritable nature. Dans son estampe éponyme, Lum a traduit en image cette imbrication entre la femme et son élément naturel notamment dans la façon dont elle fait correspondre la courbe du vêtement avec le tronc du saule, dans un mouvement fluide.
On retrouve la même correspondance entre nature et personnage dans le portrait qu’elle fait de la fée du gel et de la neige (O-Yuki, the Frost Fairy) : dans cette composition, les lignes sont au contraire des lignes droites ; la fée est traitée avec la même angularité que celle des branches nues de l’arbre, comme si le froid l’avait figée dans la même rigidité géométrique que celle des cristaux de neige. Tanabata enfin met en image une histoire bien connue des Japonais et donne à voir dans les détails du tableau des allusions claires à son contenu (le pont d’oiseaux, la lanterne qui se reflète sur le fleuve d’étoiles).

Bertha Lum, Aoyagi, 1907
Source : Berthalum.org

Bertha Lum, Tanabata, 1907
Source : Berthalum.org

Bertha Lum, O Yuki, the Frost Fairy, 1916
Source : Berthalum.org
Mais Lum ne fait pas qu’emprunter à l’Art Nouveau ses lignes fluides ; elle en reprend également les thèmes et tout particulièrement sa prédilection pour les personnifications d’éléments naturels ou de concepts sous des traits féminins. Ainsi, The Wind Sprite s’incarne sous les traits d’une jeune femme moderne arborant le bob cut typique des années folles et rappelant les flappers américaines. S’il se tient dans la même posture cambrée que La Danse de Mucha, chez Bertha Lum en revanche, c’est le voile tenu par la déesse qui fait écho à la longue chevelure ondoyante si présente dans l’oeuvre du peintre tchèque.

A. Mucha, Les Arts - La Danse, 1898
lithographie, 60 x 38 cm
Mucha Museum, Prague
Bertha Lum, Wind Sprite (Le Lutin du vent), 1917
estampe, 23,6 x 38,1 cm
Fine Arts Museum of San Francisco
Bertha Lum a aussi des affinités idéologiques et thématiques avec le mouvement préraphaélite, dont la confrérie fut fondée à Londres en 1848 : dans l’esprit de révolte contre le classicisme et le maniérisme, le refus d’obéir à des règles de composition jugées enfermantes (perspective, proportion), la volonté d’un retour aux couleurs vives et notamment aux couleurs primaires (similitudes avec le japonisme), et dans son affection pour les thèmes de la nature et des légendes médiévales. C’est particulièrement visible dans son choix de représenter des femmes fatales issues du folklore japonais et dans lequel on trouve bien des points communs avec les tableaux préraphaélites.
Dans les tableaux de Burne Jones ou de Waterhouse, il n’est pas rare de trouver des représentations de femmes qui mettent leurs pouvoirs surnaturels de séduction et de sortilèges au service d’une entreprise d’assujettissement des hommes. La fée Viviane, après avoir dérobé à Merlin tous ses secrets, l’enferme dans un arbre ; la Belle Dame Sans Merci, quant à elle, prend au piège les chevaliers égarés grâce à sa longue chevelure. Le motif de la chevelure rappelle celui du fil qu’on tisse ou qu’on brode (activité considérée comme typiquement féminine) mais qu’il est aisé de détourner en piège à destination des hommes. Cet aspect de l’iconographie occidentale se retrouve dans les déesses japonaises telles que représentées par Bertha Lum, notamment dans son estampe intitulée Spider Woman, où la femme araignée est une référence à la figure de Jorogumo qui, dans le folklore japonais, est une femme-araignée d’une grande beauté capable de tisser une toile potentiellement mortelle pour ses prétendants.
Cet aspect de la femme-déesse, femme-animal, femme fatale séduisante et non véritablement humaine se retrouve également dans les modèles de femmes-renard ou kitsune que Lum a peintes (voir The Fox-Woman et Fox Women). Abondamment présent dans les mythes japonais, le renard qui se métamorphose en femme est rusé et plein de pouvoirs, duplice car avançant toujours masqué et ne révélant son identité qu’au moment où il est contraint d’abandonner le foyer conjugal. C’est ce moment de transition qu’a saisi Yoshitoshi Tsukioka dans son estampe intitulée The Fox-Woman Kuzunoha Leaving Her Child en 1890. La femme redevient renard à l’instant même où elle passe le seuil de la porte et quitte ainsi l’espace domestique pour y retrouver sa nature animale, matérialisée par l’ombre derrière le paravent.

J.W. Waterhouse, La Belle Dame Sans Merci, 1893 huile sur canevas, 112 x 81 cm
Hessisches Landesmuseum


Bertha Lum, Spider Woman, 1936 estampe, 26 x 40,5 cm
E. Burne-Jones, The Beguiling of Merlin, 1874
Huile sur canevas, 186 x 111 cm
Lady Lever Art Gallery, Liverpool

Conclusion
Au moment où l’Occident
commence à entrevoir le potentiel moderniste et libérateur
que peut jouer l’art japonais
dans son influence sur les pratiques européennes,
« vivre le Japon »
et en emprunter les codes artistiques,
surtout pour deux femmes, constitue en soi
un acte d’avant-garde.
Bertha Lum, The Fox Woman, 1916
estampe, 25,6x41,6 cm, collection privée
Dans une perspective orientaliste, on a pu reprocher à Bertha Lum de figer le Japon et ses habitants dans un temps suspendu, de leur refuser en quelque sorte le droit à la modernité et à l’évolution, de les identifier à une vision occidentale fantasmée (« les tournant davantage en archétypes folkloriques qu’en figures dotées d’individualisme », « féminisant le Japon et reléguant ses images au rang de mythes et légendes » (Yoshihara [4]). On a aussi lu dans sa représentation de femmes-animales et femmes fatales une féminisation du Japon répondant aux clichés qui circulaient à l’époque en Occident - celui de l’Orient mystérieux, des geishas prêtes à assouvir les désirs masculins, un territoire à s’approprier et à assujettir dans une forme de domination culturelle et économique. Faut-il voir pour autant chez Helen Hyde et Bertha Lum une utilisation et mercantilisation du Japon à destination de ce public ? S’il est certain qu’elles ont su toucher le public occidental et en anticiper les goûts afin de pouvoir vivre de leurs estampes, en lui livrant un Japon peint tel qu’elles-mêmes le rêvaient, tel qu’elles eussent voulu qu’il demeure esthétiquement, elles étaient indéniablement fascinées par la beauté de ce pays qu’elles percevaient forcément comme exotique. C’est cet exotisme médiatisé qui plut outre-mer et dans lequel le public occidental put reconnaître des thèmes qui lui « parlaient » : les femmes notamment furent touchées par les représentations simples et directes que fit Helen Hyde de la maternité et de l’enfance dans lesquelles, sous le vêtement et le décor « exotique » des activités, elles pouvaient se reconnaître.
C’est en réalité le voyage et l’expérience du Japon et de son univers artistique qui tiennent lieu en quelque sorte de modernité à l’œuvre de Helen Hyde et Bertha Lum, tant du point de vue de la technique artistique (adoption du procédé créatif de l’ukiyo-e) que des thèmes qu’elles choisirent de représenter (scènes de la vie domestique, légendes tirées du folklore japonais). Au moment où l’Occident commence à entrevoir le potentiel moderniste et libérateur que peut jouer l’art japonais dans son influence sur les pratiques européennes, « vivre le Japon » et en emprunter les codes artistiques, surtout pour deux femmes, constitue en soi un acte d’avant-garde. Mais d’un autre côté, il semblerait que Bertha Lum comme Helen Hyde aient également recherché dans leur pays d’adoption quelque chose d’un havre de paix préservé de la modernisation technique et industrielle qui battait son plein aux Etats-Unis.
L’une comme l’autre expriment un fort attachement au caractère mystique et mystérieux du pays : « L’air est ici doué d'une étrange qualité, même par temps clair. Bien que le soleil brille, une brume semble flotter au-dessus de l’eau, et alors que dans d’autres contrées l'œil perçoit nettement les détails aussi loin qu’il puisse voir, ici tout semble une série de silhouettes, comme si le paysage incarnait en lui-même la croyance bouddhiste selon laquelle toute existence n'est qu’illusion sans substance ; l'enseignement que la vie n’est qu’un théâtre d’ombres. » Dès lors que le Japon semble emboîter le pas à l’Occident dans sa course à la modernisation, Helen Hyde préfère s’en aller : « Hyde refusa d’embrasser la nouvelle réalité que l’industrialisation, comme elle l’avait fait en Europe et aux Etats-Unis, apportait au Japon. Il n’y avait plus rien à dessiner, écrivit-elle dans une lettre à sa famille en 1914 : « même les gens sont devenus laids. » »
Viviane LE BERRE
©2019 by Viviane Le Berre/Tokyo Time Table

NOTES
[1] Siegfried Wichmann, Japonisme (1980), Londres, Park Lane Editions, 1985, trad. V. Le Berre, p. 10.
[2] E. J. Blattner, “Helen Hyde, An American in Japan”, The International Studio, November 1911, trad. V. Le Berre, p. 54.
[3] Bertha Lum, Gangplanks to the East, NY, Henkle-Yewdale House, 1936, trad. V. Le Berre.
[4] Yoshihara, Mari : Embracing the East; White women and American Orientalism, Oxford University Press, 2002, trad. V. Le Berre, p. 59.
[5] Bertha Lum, Gangplanks to the East, op.cit., trad. V. Le Berre, p. 14.
BIBLIOGRAPHIE
De Bertha Lum elle-même, Gangplanks to the East, NY, Henkle-Yewdale House, 1936.
– Blanchard, Mary Warner : Oscar Wilde’s America: counterculture in the Gilded Age, Yale University Press, 1998.
– Burke, Doreen Bolger et al : In Pursuit of Beauty: Americans and the Aesthetic Movement, NY, Metropolitan Museum of Art, 1986.
– Brown, Kendall : Dangerous Beauties and Dutiful Wives, Popular Portraits of Women in Japan, 1905-1925, NY, Dover publications, 2011.
– Gravalos, Mary Evans and Pulin, Carol : Bertha Lum, Washington, American Printmakers: A Smithsonian Series, 1990.
– Jensen, Joan M : Helen Hyde, Washington, American Printmakers, University of Purdue, 1998.
– Mason, Tim et Lynn : Helen Hyde, Washington, American Printmakers: A Smithsonian Series, 1991.
– Mathews, N. Mowll et Curie, Pierre : Mary Cassatt, une impressionniste américaine à Paris, Bruxelles, Fonds Mercator, 2018.
– Saïd, Edward : L’Orientalisme (1978), Paris, Editions du Seuil, 1997.
– Wichmann, Siegfried : Japonisme (1980), Londres, Park Lane Editions, 1985.
– Yoshihara, Mari : Embracing the East; White women and American Orientalism, Oxford University Press, 2002.